Après être revenu sur l’historique du développement du sport en France, Benjamin Coignet, sociologue et directeur adjoint de l’Agence pour l’éducation par le sport, et Thibaut Desjonquères, directeur du cabinet Pluricité, émettent l’hypothèse de l’existence d’initiatives sportives spécifiques aux quartiers populaires et apportent des pistes de réflexion pour que le sport joue à fond son rôle socio-éducatif sur ces territoires.
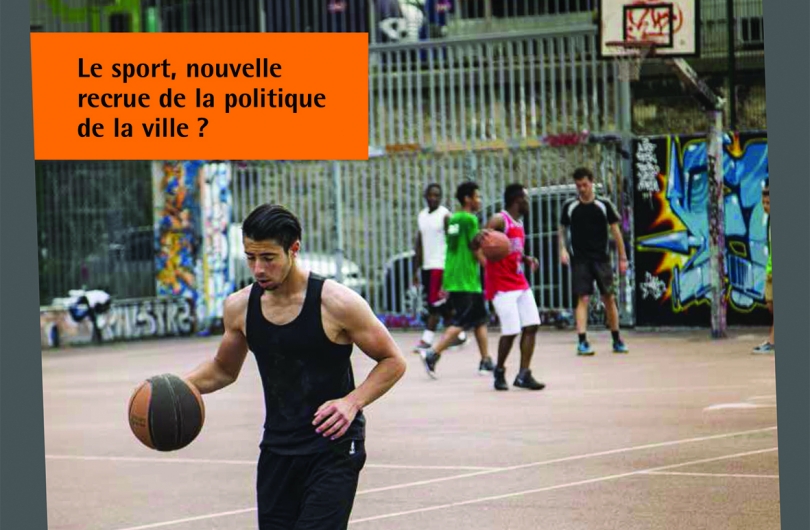
Le sport a pris naissance au sein de l’élite sociale de l’Angleterre industrielle du XIXe siècle, dans des collèges. Il a connu par la suite une diffusion planétaire exponentielle : son modèle éducatif et son organisation compétitive ont franchi les frontières pour devenir un vecteur majeur de la mondialisation culturelle. Il s’est diffusé en s’institutionnalisant au sein de fédérations et d’un mouvement olympique qui transcende les nations.
La diffusion protéiforme du sport
En France, une étape décisive dans le rapprochement entre l’État et les organisateurs « légitimes » du sport fut la promulgation de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dite loi Avice. Cette dernière précise que les fédérations sportives agréées sont chargées de « développer et d’organiser la pratique des activités sportives, d’assurer la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles et de délivrer les titres fédéraux » dans le cadre d’une mission de service public. La charpente institutionnelle est depuis solidement posée et donne une ligne directrice aux fédérations.
Parallèlement à cette mécanique, dès les années 1970, les sportifs se sont diversifiés. Ils ont pris des libertés par rapport aux fédérations sportives et aux espaces de pratique normés : les sports de nature ont connu un pic d’intérêt ; les friches urbaines sont devenues des terrains de jeu stimulants pour la jeunesse qui y a fait naître différentes disciplines sportives et artistiques. Le sport a endossé plusieurs finalités sous l’impulsion des pouvoirs publics locaux et d’entraîneurs- éducateurs-animateurs implantés dans des micro-territoires qui ont voulu répondre aux besoins sociaux. Des innovations sociales par le sport ont fleuri, dans un rapport ambigu avec les pouvoirs sportifs nationaux, régionaux et départementaux.
Le sport du dimanche, comme le sport en club compétitif voire de haut niveau, est traversé par des phénomènes qui affaiblissent son action sociale et éducative : racisme, discrimination, dopage, violence, corruption, surmédiatisation, pour n’en citer que quelques-uns. Sa capacité à inventer et à créer de la solidarité est incertaine : la question de la compétition, qui se résume à « qui va gagner ? », est encore (trop ?) souvent la principale préoccupation irriguant l’action des acteurs du sport et, par ricochet, celle des politiques publiques et des financeurs. Qu’en est-il de sa diffusion dans les quartiers populaires, dont on dit qu’ils concentrent de nombreux maux de la société et qu’ils génèrent des déviances juvéniles ?
Le sport dans les quartiers : entre inégalités et spécificités
Y a-t-il, d’abord, des chiffres disponibles, valables et éclairants ? Depuis les années 2000, l’État s’intéresse au recensement des licenciés et des équipements sportifs dans les quartiers prioritaires, pour mesurer le degré des inégalités territoriales d’accès au sport. Ces chiffres sont discutables car le zonage évolue au gré des années et des dispositifs politiques. Les clubs locaux et leurs fédérations ne sont pas tous équipés pour géolocaliser leurs licenciés : les freins idéologiques sont prégnants (par exemple le refus de ficher les pratiquants). L’Observatoire des zones urbaines sensibles précisait en 2011 puis en 2015 que les quartiers prioritaires :
- enregistrent une proportion de femmes licenciées inférieure à celle de leurs homologues masculins (2,9% contre 4,1%) ;
- accueillent moins de 3% des équipements sportifs du territoire national ;
- connaissent une surreprésentation des terrains de proximité et des salles multisports de type « gymnases ».
Et que savons-nous des sportifs non licenciés et occasionnels ? À ce jour, nous ne pouvons l’estimer. Les chiffres nationaux peuvent donner quelques tendances approximatives, mais ne sont pas suffisants pour comprendre l’ampleur du phénomène sportif de quartier. Bien qu’il soit difficile de chiffrer son étendu, le sport est présent dans les quartiers prioritaires, apprécié et diversifié dans ses formes d’organisation, ses disciplines et ses espaces. On peut y jouer au football dans des clubs, évoluer en vélo sur des pistes cyclables, faire son footing le dimanche matin ou même parfois aller à la patinoire ! Il faut aller sur les territoires et multiplier les observations pour estimer la spécificité sportive des quartiers. En faisant ce travail, on peut avancer l’hypothèse que les logiques sociales, politiques et institutionnelles qui irriguent les quartiers populaires influent sur le développement du sport et en donnent une certaine coloration. Il suffit de voir comment des pratiques hybrides alliant sport et culture (le hip-hop, par exemple) ont émergé sous l’impulsion créative de « jeunes de banlieue » pour s’étendre à d’autres territoires. Les quartiers prioritaires sont également source d’une grande attention des représentants des politiques sportives, qu’ils soient d’État, des collectivités locales voire des fédérations sportives qui cherchent à « s’implanter », sans avoir de méthode dans la plupart des cas. Toutes ces logiques donnent l’occasion au sport de poursuivre sa diffusion, mais en se réinventant constamment pour coller aux problématiques sociales des quartiers.
Des expérimentations locales remarquables
La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un vivier d’acteurs ayant expérimenté depuis plus de trente ans des actions sportives dans les quartiers. On peut citer l’Association sportive des Minguettes, à Vénissieux, qui a fait évoluer la pédagogie sportive des entraîneurs de football au-delà des frontières locales. Grâce à l’appui d’un laboratoire de recherche 1 et de protocoles éprouvés scientifiquement, plusieurs générations d’enfants ont été encadrées et évaluées dans l’acquisition de compétences psychosociales indispensables à la vie civique. Cette initiative a apporté des connaissances par la suite reprises dans les formations fédérales d’entraîneur. Dans un autre registre, l’association Action basket citoyen s’appuie sur l’attrait pour le basket de rue, discipline qui n’a pas trouvé de soutien au sein de la fédération dans les années 1990, pour tisser un lien avec des jeunes et pour favoriser leur suivi scolaire. À l’aide d’un bus et d’un kit de pratiques, les bénévoles puis les salariés ont animé les quartiers populaires de la région lyonnaise et ont construit des passerelles vers les clubs locaux. Les initiatives sportives sont multiples dans les quartiers prioritaires d’Auvergne-Rhône-Alpes. Elles recouvrent des finalités dispersées (intégration d’habitants dans un club, accompagnement social via « l’outil sport », etc.) et des logiques d’émergence différentes : parfois les pouvoirs publics sont impulseurs, parfois les habitants s’auto-organisent sans se raccrocher aux dispositifs. La nébuleuse sportive de quartier a le mérite de montrer la créativité de certains acteurs locaux qui se saisissent du potentiel éducatif du sport pour répondre aux besoins d’un segment de la population. Cette diversité permet de (re)découvrir l’utilité sociale du sport.
Acteurs du sport/pouvoirs publics : à quand la rencontre ?
Plusieurs conditions sont nécessaires pour voir émerger et perdurer une offre sportive de quartier en phase avec les besoins sociaux. Tout d’abord, il semble indispensable de repenser la place de tous les acteurs du sport de quartier dans les dispositifs publics. Beaucoup de petits clubs générateurs d’un tissu social de proximité sont réfractaires à la culture écrite des administrations et, par conséquent, méconnaissent voire rejettent les opérations ou appels à projet… alors qu’ils soudent des familles, captent des jeunes en échec scolaire, les mettent en réseau avec des acteurs de l’insertion, et font un travail précieux au quotidien. De l’autre côté, des chargés de mission, animateurs, coordinateurs des contrats de ville méconnaissent les logiques socio-éducatives des clubs sportifs. Ensuite, les acteurs du sport doivent certainement aussi s’ouvrir sur les politiques sociales, éducatives, de cohésion sociale. Beaucoup de dirigeants de clubs, salariés et bénévoles, rejettent instinctivement les orientations politiques en direction de publics cibles. Il suffit de voir les levées de bouclier du mouvement sportif depuis quelques années sur les financements du Centre national pour le développement du sport qui flèche les subventions en direction de micro-projets dans les quartiers ! Les dirigeants qui rentrent dans cette logique pour reconfigurer leurs actions de club offrent de belles perspectives de développement à leurs associations. En somme, des espaces de rencontre sont à créer pour permettre aux acteurs du sport dans leur diversité de collaborer avec des acteurs de la jeunesse, du social, de l’insertion par l’économique, de l’éducation au sein des quartiers prioritaires.
••• Benjamin Coignet et Thibaut Desjonquères
1 - Le Centre de recherche et d’éducation sport et santé. Lire à sur ce sujet, l’article de la présidente fondatrice du Cress, Béatrice Clavel-Inzirillo, p. 24.



